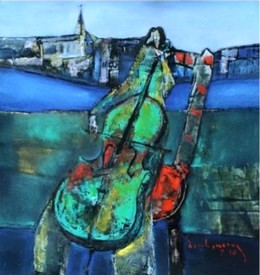Bạch Thái Hà
.
La France accueille chaque année plus de 200 000 étudiants étrangers, 245 000 étudiants de nationalité étrangère inscrits en 2002-2003, soit 10,9% du total (1). Selon la revue trimestrielle Bèo (2) éditée à Paris, pour la rentrée d’Octobre 2004, 4 800 étudiants vietnamiens fréquenteront les établissements d’enseignement supérieur et de centre de recherche de renommée internationale : plus de 3000 établissements dont 90 universités, 240 écoles d’ingénieur, 230 écoles de commerce et 2000 établissements (écoles d’art, d’architecture, d’études paramédicales…).
Avant d’entrer dans les universités, ces étudiants passent un test de connaissance de langue française (TCF) équivalent au TOEFL anglais, ils peuvent préparer ce test au Viet Nam. Sinon ils doivent passer le DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française) et le DALF (Diplôme Approfondi en Langue Française), diplômes officiels de Français Langue Etrangère (FLE) pour pouvoir accéder aux études supérieures.
La plupart des étudiants vietnamiens résident en Ile de France (2000), viennent ensuite Grenoble (500), Lyon (400), Aix-Marseille (400), Toulouse (300). Les lauréats 2004 pour une bourse pleine (DEA-DESS-Master), pour une bourse à coûts partagés (DEA-DESS-Masters) ou pour une bourse de Doctorat sont affichés sur le site internet de l’Ambassade de France (3). Ceux-ci bien informés et orientés, s’inscrivent sans difficulté dans les écoles de leur choix et peuvent bénéficier tout de suite des prestations sociales réservées aux étudiants étrangers.
Cependant la plupart, au nombre de 2 221 selon l’Ambassade de France à Hanoï poursuivent leurs études en France avec un bagage de français très rudimentaire qui ne dépasse pas le niveau de 6è d’un élève français de 11 ans. Le Viet Nam n’est plus un pays francophone depuis longtemps bien que la France ait fait un effort encourageant pour faire revenir le Viet Nam dans l’espace francophone. Il suffit de constater les 2 milliards de dollars envoyés par la diaspora vietnamienne chaque année pour aider la famille. La grande majorité des envois proviennent des Vietnamiens résidant aux Etats-Unis. La France occupe plutôt une place de conseil juridique, de high-tech, de conservation des sites archéologiques et historiques et de l’élaboration d’infrastructure.
Dès leur arrivée en France, certains étudiants étalent leur drapeau rouge à étoile jaune pour une pause de souvenir à Nancy (4) comme s’ils allaient en compétition pour décrocher une médaille quelconque !
Ces étudiants ont une connaissance très vague de la société française, ils ignorent ce qu’est la démarche pour avoir une carte de séjour ‘étudiant’, la sécurité sociale, les assurances, la location ou la co-location d’un logement et les transports. Ils ne savent pas que les frais d’ inscription dans un établissement (environ 250 € par an) est le moins cher du monde alors que la France doit dépenser environ 7 000 € par an pour former un étudiant.
Leur séjour en France est vraiment un parcours du combattant. Comme ils parlent mal le français, ils se tournent vers leurs compatriotes fraîchement arrivés et ils se trouvent dans un cercle vicieux. Les uns sont exploités par d’autres vietnamiens sans scrupules pour avoir un certificat d’hébergement, s’inscrire dans une école, trouver un logement (un studio de 15 m2 pour 4 personnes !). Les autres se font arnaquer par une agence fantôme en lui remettant 5 000 € croyant qu’elle s’occupait tout à la fois le loger, le manger et les études.
La revue Bèo qui prétend aider les étudiants à intégrer dans la société française afin de tirer le maximum de l’enseignement enrichissant n’est pas à la hauteur de sa tâche. Les traductions de quelques mots français en vietnamien sont erronés et des fois incompréhensibles.
Quelles sont les difficultés quotidiennes que rencontrent les étudiants vietnamiens ?
Tout d’abord les transports : ils prennent le métro, le bus, la SNCF mais repèrent difficilement sur un plan du Métro ou sur une carte routière l’endroit où ils veulent aller. Les cartes géographiques ne sont pas usuels au Viet Nam. Ils s’expriment mal leur pensée, même pour une simple information comme la bouche du métro, la baguette, le nom d’une rue, les horaires des trains…Certains sons n’existent pas en vietnamien : le u, le roulement du r, les deux s, le p, le ps, les syllabes un et in. La conjugaison et la concordance des temps les déroutent complètement. Déjà, les vietnamiens qui résident en France depuis une trentaine d’années ont dû mal à assimiler la langue de Molière.
En tant qu’étrangers, ils ne peuvent ouvrir à la Banque qu’un compte étranger et tout virement bancaire doit être justifié (ex. fiche de paie, chèque en dollars (avec commission) ou en euros et jamais en espèces). Certains voient leur compte fermer par le Crédit Lyonnais de Masséna voyant leur clientèle toujours verser en espèces les euros dans leur compte tout en taxant une amende de 100 (Bèo, p.21).
Quant à la sécurité sociale, les étudiants étrangers reçoivent un numéro particulier qui ne correspond pas au numéro de sécurité sociale normale et donc pour travailler ils ne doivent pas dépasser les 19,5 heures par semaine ou 800 heures par an. Souvent ils travaillent au noir dans des restaurants chinois, turcs ou vietnamiens. En gagnant peu, ils n’ont pas le temps de perfectionner le français et surtout l’étude du français coûte cher et ils ne savent pas se débrouiller avec les méthodes audio-visuelles de langue française au Centre Pompidou ou dans les diverses bibliothèques dans la Capitale.
Quant aux repas de tous les jours, ils se lassent rapidement des plats servis par le CROUS, ils préparent dans leur studio très réduit le riz les vermicelles et les nouilles et quelques denrées exotiques achetées au marché chinois.
Pour bien intégrer dans la sphère estudiantine française, veuillez consulter sur internet le site de l’Ambassade de France à Hanoï en particulier et les sites suivants :
 . www.etudiantdeparis.fr
. www.etudiantdeparis.fr . www.eduparis.fr
. www.eduparis.fr . http://edufrance.fr/vietnam
. http://edufrance.fr/vietnam . www.vietnamduhoc.com
. www.vietnamduhoc.com
Bach Thai Ha
Paris Sep 2004
(1)- Le Monde 10/09/2004, p.10
(2)- Bèo, No 9, Mars, Avril, Mai 2004
(3)- www.ambafrance.org/etudefr//index.htm
(4)- Photo prise par Bèo, p.17.