Pour notre retour vers la plaine, mine de rien, nous avions marché pendant toute l’après-midi, jusqu’au moment où le soleil commença à décliner vers l’Ouest. Mon père s’arrêta devant une petite auberge et invita tout le monde à y entrer pour boire un coup et prendre quelque repos. L’auberge était assez animée ; les buveurs nous observaient sans animosité. En regardant dehors, je vis, sur le petit chemin, deux guérilleros portant une grosse mine sur une palanche. Ils la déposèrent avec précaution sur le bord de la route et entrèrent dans l’auberge. Les clients et nos deux guérilleros conversaient gaiement ; il semblait qu’ils se connaissaient bien, car ces résistants ne cachèrent pas leur mission : cette nuit-là, ils devaient aller poser la mine en s’infiltrant dans le poste de garnison français. Je ne savais pas comment ils s’y prendraient, mais c’était une mission difficile et dangereuse et ils risquaient d’y laisser leur vie. Le soleil allait se coucher et les guérilleros partirent, chargés de leur mine. Je les regardai s’éloigner, le cœur un peu serré, empli d’admiration pour leur courage et pour leur sens du sacrifice. C’était ça, la guérilla : une guerre d’usure menée contre un ennemi plus puissant, en armes comme en munitions ; et il ne manquait pas, dans le pays, de ces partisans courageux, prêts à se battre pour une juste cause et acceptant volontiers de sacrifier leur vie pour la défendre.
Plus tard, en lisant Saint-Éxupéry, je retins cette citation célèbre, en pensant à nos deux résistants rencontrés dans l’auberge, lors de notre déplacement vers la plaine :
Bien que la vie humaine n’ait pas de prix, cependant, nous agissons toujours comme si quelque chose dépassait en valeur la vie humaine.
Lorsque nous quittâmes l’auberge, le soleil était déjà sur le point de disparaître à l’horizon. Quand nous sommes arrivés à l’embarcadère d’un grand fleuve, les derniers rayons du soleil commencèrent à disparaître pour céder la place au crépuscule dont la pénombre enveloppait tout le paysage. Je contemplai le fleuve ; sa surface immense m’impressionnait beaucoup ; cette étendue vide et triste me rebutait. Un calme plat y régnait, pas une âme ne bougeait. Nous attendions le sampan qui nous emmènerait vers l’autre rive. Pendant cette attente interminable, au bord d’un fleuve aux eaux écumantes, presque désert, je sentais combien la nature était menaçante et combien nous étions petits, face à son immensité et ce fleuve en constituait l’un des éléments les plus représentatifs. Le crépuscule ne dura pas longtemps, pourtant on était au mois de mai. Doucement et sûrement, bientôt arriva l’obscurité de la nuit. Toute la famille commença à s’inquiéter : comment traverser ce fleuve, alors que la nuit allait bientôt arriver ? Où se loger pour passer la nuit ? Heureusement, nous vîmes de loin glisser sur l’eau, vers notre direction, un sampan dirigé par une jeune fille, où nous pûmes tous embarquer. Durant la traversée de ce fleuve aux vagues assez agitées, le clapotement de ces eaux de chaque côté de l’embarcation ne manqua pas de nous inquiéter. Grâce à cette jeune sampanière, nous avons pu gagner l’autre rive, sains et saufs, et mon père nous apprit alors le nom de ce fleuve : le Thu Bồn.

De cette traversée, je garde l’image impressionnante de ce grand fleuve et je pense au dur métier de cette toute jeune paysanne, à la silhouette gracile et souple ; à chaque traversée, elle devait lutter contre la nature sauvage, représentée par cette immense étendue d’eau aux vagues agitées, toujours menaçantes, à la merci, de surcroît, des caprices du temps. Pourtant, l’évocation de l’image d’une barque glissant sur l’eau, manœuvrée par une jeune sampanière, ne manquait pas d’un charme romantique : une image dont le cadre idyllique était constitué par un fleuve tranquille aux rives recouvertes d’une épaisse verdure, plantées d’arbres dont l’ombre protégeait les promeneurs se déplaçant le long du fleuve, en période de grande chaleur.
Cette image de la sampanière qui exerçait un métier, réservé la plupart du temps, à des jeunes filles au visage charmant, est entrée dans la poésie vietnamienne : le poète Nguyên Bính chante l’histoire amoureuse, née de la rencontre entre un passager et une gracieuse sampanière, à l’occasion d’une traversée, dans son poème Cô Lái Đò. L’écrivain et poète Hô Dzênh, dans ses écrits, évoque cette scène, alors que le crépuscule noie de sa pénombre l’eau clapotante. C’était ainsi que s’était formé ce couple sino-vietnamien. De cette union était né un fils, le futur poète Hô Dzênh.
En lisant Hô Dzênh et l’histoire d’amour de ses parents, née de cette heureuse aventure, je m’imagine combien fut romantique cette idylle – au moins pendant les premières années de leur union – et je la rapproche de notre traversée du fleuve Thu Bồn, car on y trouve des points communs : les sampanières étaient toutes deux des jeunes filles à la fleur de l’âge ; elles apparurent toutes seules sur la vaste étendue d’eau, au même moment de la journée, le plus triste. L’ombre de la nuit commençait doucement à envelopper toute la campagne où régnait un silence effrayant. Je me demande d’ailleurs pourquoi ce travail pénible de rameur, qui présentait, en outre, un risque évident, était confié, dans la plupart des cas, à une toute jeune fille.
Plus tard, j’ai commencé à faire connaissance avec ce grand fleuve. Il prend sa source sur le mont Ngọc Linh, à une altitude de deux mille cinq cent dix-huit mètres ; il franchit ensuite la région montagneuse du Sud-Ouest, en traversant les différents districts de la province de Quang Nam. Parvenu à la plaine, après avoir arrosé de ses eaux la petite ville de Hôi An, il finit sa course dans la mer, à Cửa Đai, située à cinq kilomètres de là. Comme il effectue une longue course, des montagnes occidentales jusqu’à la plaine, il est devenu la voie fluviale par excellence qui favorise les déplacements des hommes et des marchandises entre la plaine et la région montagneuse. Ces échanges commerciaux, notamment de denrées alimentaires, entre ces régions situées l’une en amont, l’autre en aval du fleuve, s’expriment dans cette chanson populaire :
Quiconque vit en aval du fleuve rappelle à ses amis : « Envoyez-nous des jacquiers encore verts et nous, en retour, nous vous enverrons des poissons volants. »
Ce fleuve est source de vie pour toutes ces régions de Quảng Nam, qu’il arrose généreusement de ses eaux limoneuses ; chaque année, en période de crue, elles sortent de leur lit et inondent jardins et terres des villages proches du fleuve ; les limons qu’elles y déposent après leur retrait rendent les terres plus fertiles. Cela donne une végétation exubérante et permet aux habitants de faire pousser une grande variété d’arbres fruitiers. On ne trouve ceux-ci que dans la province du Sud, appelée Đồng Nai, réputée pour la richesse, en quantité comme en qualité, de ses fruits. Vu la ressemblance entre les deux végétations, cette région, appelée Đại Bường, située aux confins des montagnes, a pris le surnom de Tiểu Đồng Nai (le petit Dông Nai).

Pourtant, à partir des mois de novembre et de décembre, quand arrive la saison des pluies, ce fleuve se transforme en un grand torrent et, en quelques heures, ses eaux peuvent monter de plusieurs mètres et emporter tout sur leur passage, apportant le malheur aux riverains. L’une de ces catastrophes naturelles fit beaucoup de victimes : en 1964, pendant la nuit, la montée des eaux fut tellement rapide que certaines familles, surprises dans leur sommeil, n’eurent pas le temps de se sauver et elles furent emportées par les eaux dans leur course tumultueuse. Ce fleuve, dans sa folie meurtrière, charriait tout sur son passage : les maisons en brique, les paillotes, les buffles, les bœufs, tous furent happés par ce torrent démentiel. Mon oncle Trân Cảnh et son épouse faillirent eux-mêmes être emportés par les flots. Leur maison en brique était submergée, mais, grâce à l’aide de leur neveu, ils purent monter sur le toit. Un sampan, fort heureusement, arriva à temps pour les sauver d’une mort imminente, car, quelques minutes après, leur maison fut emportée par ce courant impétueux. Cependant leur fille et ses quatre enfants, surpris par cette crue subite, n’eurent aucune possibilité d’échapper à la noyade. Avant de mourir, la mère eut juste le temps de s’attacher avec ses quatre enfants pour éviter que leurs corps ne fussent emportés par les eaux. Quelle tragédie pour nous tous devant cette catastrophe qui avait causé tant de malheurs !
Il y a quelques années, lors d’une de mes visites à Hôi An, j’ai eu l’occasion d’aller visiter cette contrée dans la voiture conduite par Sơn, en compagnie de son épouse Huyền, une grande amie de ma nièce Thanh Tuyêt. Après quarante-cinq minutes de route, avant de traverser la ville de Hà Lam, nous nous sommes arrêtés dans une auberge pour prendre un petit-déjeuner. Nous avons commandé un bol de mì gà (soupe au poulet et pâtes jaunes). Nous avons bien senti la différence de goût entre le mì gà de Hôi An et celui de la campagne : ici, les volailles étaient élevées en liberté et, par conséquent, leur goût était meilleur, plus savoureux et plus fin. Après Hà Lam, la route devint sinueuse, escarpée, comportant de nombreux virages. Grâce à sa conduite remarquable et à son véhicule à quatre roues motrices, ce ne fut pour Sơn qu’un « jeu d’enfant » ! J’ai eu ainsi le plaisir d’admirer ce beau paysage tout au long de notre excursion. Il était midi quand nous parvînmes à un beau site, le col de Đèo Le.
Déjà, à Phú Xuân, en 1946, j’avais entendu mon père parler de ce col réputé, lorsqu’il projetait de s’installer à Ti Sé. Pour se rendre dans cette contrée, il fallait, en effet, franchir ce col. Or, mon père doutait de la capacité physique de ma mère à pouvoir atteindre, à pied, ce col ; car, après notre longue marche de Phú Xuân jusqu’au pied de cette montagne, ma mère, mais nous aussi, aurions été exténués. Dans ces conditions, comment aurions-nous eu encore la force pour accomplir une telle prouesse ?

Plus de soixante ans après, grâce à Sơn et Huyên, j’ai enfin pu contempler de mes propres yeux ce beau paysage, vu du col, et, un peu plus loin, les chaînes de montagne qui s’étendaient à perte de vue. Son arrêta sa voiture au pied du col et nous conduisit dans une auberge. Celle-ci comportait une grande terrasse bien ombragée où nous avons déjeuné en plein air. Ce col est connu non seulement pour son aspect pittoresque, sa situation dans un paysage majestueux de forêts et de hautes montagnes, mais aussi pour sa spécialité régionale, connue sous le nom des poulets sauvages du col Đèo Le. Nous avons goûté cette spécialité exceptionnellement savoureuse. Cette qualité vient du fait que ces volailles vivent à l’état sauvage. Seule dans cet endroit isolé, loin des agglomérations, vit encore cette espèce d’oiseaux. Pourchassée constamment par l’homme, leur prédateur, elle serait en voie d’extinction. Espérons toutefois qu’elle sera protégée par les hautes montagnes, leur refuge naturel, difficiles d’accès.
Après un repas bien arrosé, nous avons poursuivi notre route en direction de Đại Bường, en longeant le fleuve Thu Bồn dont les eaux, en été, se réduisent à un écoulement bien modeste ; en regardant ce fleuve vers l’aval, on avait du mal à s’imaginer que, en période des grandes crues, les pluies diluviennes, en quelques jours, pouvaient, avec le concours du vent soufflant en tempête, le transformer en un gigantesque torrent, causant tant de ravages, en vies humaines comme en biens matériels.
À Đại Bường, nous nous sommes promenés dans un immense verger qui nous enchanta, car il offrait une incroyable variété de végétaux ; on y trouvait des arbres majestueux, ainsi qu’une grande variété de splendides plantes à fruits : pêchers, pruniers, manguiers, pamplemoussiers, avocatiers et bananiers. L’ombrage de ces arbres nous protégeait de l’ardeur de ce soleil estival. Ce coin de paradis terrestre nous apporta une profonde détente ; nous nous y sentions à l’abri de l’agitation des villes, petites ou grandes, où affluent les touristes. Nous profitions de cet espace de rêve, car, de temps à autre, on apprécie un moment de repos, une tranquillité bienfaisante. Cet endroit répondait parfaitement à nos aspirations, à nous, les citadins en quête de verdure et de calme.
Il était bientôt seize heures ; nous devions rentrer. Nous avons longé le fleuve, empruntant une petite route escarpée aux virages malaisés.
Nous avons quitté Đại Bường, qui mérite bien son surnom de Tiểu Đồng Nai, gardant un souvenir inoubliable de cette excursion. C’est grâce au fleuve Thu Bồn que nous bénéficions de ce beau paysage verdoyant. Avec ses nombreux affluents, ce fleuve irrigue généreusement toutes les régions qu’il traverse. Ses ramifications parcourent la plaine, pour finir sa course dans la mer, à Cửa Đại.
Depuis 1995, presque tous les ans, je retourne à ma ville natale, Hôi An. Là, chaque soir, je me balade le long du fleuve Thu Bồn, qui prend un autre nom, Sài Giang, lorsqu’il traverse cette cité ancienne. J’admire la vaste étendue du fleuve, en tentant de distinguer l’autre rive, où se situe un village dont les habitants se consacrent au métier de menuisier. Je reste là, immobile, à contempler le magnifique coucher de soleil. Quand son disque rouge disparaît dans le lointain, sous la frondaison des arbres, c’est alors le moment où le crépuscule commence à assombrir le paysage et noie de sa pénombre l’eau légèrement agitée ; ce triste moment crépusculaire annonce la venue de la nuit et, tout à coup, mon cœur se serre en pensant à notre traversée de ce fleuve, il y a bientôt plus de soixante-dix ans (1946), juste au moment où la nuit allait tomber. C’était le même ciel, la même terre, le même moment crépusculaire. Ce fleuve demeure toujours là, sans changer, dans son éternelle jeunesse, mais où sont mes parents, mes frères et mes sœurs qui étaient avec moi lors de cette inoubliable traversée ? Seuls encore vivants mon grand frère Mãng, âgé de quatre-vingt-quinze ans et moi, déjà octogénaire. L’homme passe, mais la nature, représentée par ce fleuve indomptable, demeure toujours là.
Contrairement à ce que disait le philosophe grec Héraclite dans sa célèbre maxime : Tu ne te baignes jamais deux fois dans le même fleuve, la nature semble pour moi être toujours immuable ; elle se perpétue éternellement, alors que je sens combien est court l’espace de temps de notre vie, dépassant exceptionnellement les cent ans.
De nos jours, notre fleuve, en traversant cette cité ancienne, de l’Ouest à l’Est, joue un nouveau rôle aussi important que celui d’autrefois. S’il y a trois siècles, en tant que port fluvial, il accueillait les bateaux étrangers et assurait la prospérité économique du pays de Đàng Trong, à notre époque, il contribue, par sa vaste étendue d’eau, à attirer les touristes venus de la plupart des pays occidentaux et orientaux. En effet, après la visite à pied de l’ancienne ville, les touristes peuvent flâner tout le long du fleuve, pour prendre le frais et contempler le cadre romantique et pittoresque du fleuve aux eaux caressées par la brise ; celle-ci, venant de la mer dans le lointain, apporte un air marin frais et salubre, sans aucune pollution. Lors de sa traversée de Hôi An, le fleuve semble vouloir cacher aux paisibles habitants de cette cité sa nature fougueuse, faisant émerger en son milieu un îlot qui le divise en deux ; en effet, parvenu à Hôi An, ses eaux deviennent plus paisibles et coulent lentement ; ses petites vagues sont inoffensives. On dirait qu’il semble vouloir y rester plus longtemps pour imprimer dans ses eaux les images pittoresques au charme désuet et unique de l’ancienne petite ville. Sài Giang ne reprendra sa course fougueuse et son ancien nom, Thu Bồn, qu’après avoir dépassé cet îlot.
Les touristes peuvent également monter à bord d’une petite embarcation, propulsée à la rame par une sampanière qui leur fait admirer la ville. Celle-ci, vue du fleuve, se cache, de temps à autre, derrière des cocotiers plantés tout le long du cours d’eau ; lors de cette agréable promenade tranquille, le petit sampan glisse doucement sur cette eau qui remue à peine.
Mais pour ceux ou celles qui veulent vivre des moments plus forts sur ce fleuve à la vaste étendue et aux eaux impétueuses, ils peuvent faire une mini-croisière en s’embarquant sur de petits bateaux à moteur qui les conduisent jusqu’à l’embouchure. Là, ils peuvent voir s’étaler devant eux l’océan Pacifique dans son immensité majestueuse. Le spectacle devient impressionnant quand le fleuve, mobilisant toutes ses eaux, s’apprête à se jeter avec toute sa force dans cet océan, la mère des mers. Il est temps de faire demi-tour. Un peu plus loin, en effet, la rencontre entre les deux courants peut provoquer des vagues susceptibles de renverser le bateau…
J’ai tant de fois, depuis un quart de siècle, fait des croisières sur différents fleuves du monde : le Nil, la Volga, le Danube, le Rhin, le Yangsi Jiang… Chaque fleuve présente des attraits particuliers qui captivent les touristes, telle la Volga avec ses gigantesques écluses, le Yangsi Jiang avec ses trois gorges ; toutefois, si beaux, si majestueux que soient ces fleuves, ils n’ont jamais fait vibrer mon cœur. Alors que chaque fois que je fais une petite croisière sur « mon » fleuve, le Thu Bồn, tant de souvenirs semblent réapparaître dans mon esprit. Ce fleuve et la petite ville de Hôi An restent à jamais gravés dans mes souvenirs, telles deux entités inséparables dont l’une ne pourrait exister sans l’autre, comme la Seine et Paris, la Neva et Saint-Pétersbourg, le Nil et la capitale de l’Égypte… Sans ce fleuve, la cité de Hôi An ne serait sans doute pas ce qu’elle est aujourd’hui : l’un des hauts lieux du tourisme.

Né dans cette ville, j’ai le sentiment d’y avoir laissé à jamais mon cœur. Chaque fois que j’y reviens, en me promenant le long de ce fleuve, j’opère une sorte de retour à mes racines, bref, en le contemplant, j’ai le sentiment de me ressourcer, ce qui me permet d’avoir plus d’énergie et d’aborder l’existence dans des conditions optimales.
Après la traversée du fleuve Thu Bồn, au moment où la nuit allait tomber, je ne me rappelle plus combien de temps nous dûmes marcher pour arriver à Tiên Đọa. Le seul souvenir qui me reste, c’est le moment des retrouvailles de mes tantes et de ma famille. Nous étions tous heureux d’avoir pu atteindre, après cette longue marche, notre objectif : revenir à la plaine sains et saufs. Nous ne cachions pas la joie d’avoir quitté cette contrée montagneuse. Nous avions pu enfin nous en éloigner et nous avions le sentiment d’avoir échappé de justesse à un « enfer terrestre ». Pourtant, nous avions une petite pensée pour ceux qui y vivaient, surtout Madame Cam et ses deux fils dont nous avions tant apprécié la gentillesse et le sens de l’hospitalité. Nous leur en serions éternellement reconnaissants.
Extrait du livre : « Souvenirs de mes années vécues au Vietnam – Une guerre de trente ans (1945 – 1975)» de Nguyen Thanh Trung
L’Harmattan – juin 2022
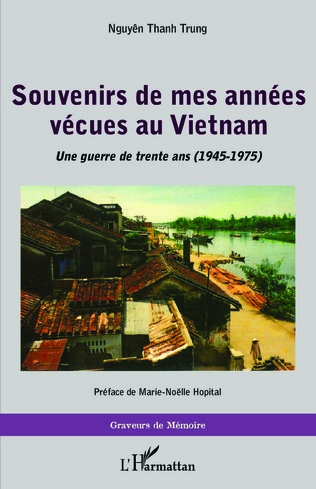
.
